Depuis l’arrivée à l’investiture de Donald Trump, le 20 janvier dernier, la plupart des analystes politiques reconnaissent des actes forts dans les premières semaines du président américain avec des révélations tonitruantes comme les financements de l’USAID.
Mais pour beaucoup, le jeu de Trump et la politique extérieure américaine est encore difficilement lisible. Il faut attendre les actes.
Un aspect de la politique extérieure des États-Unis semble lié à la personnalité de Donald Trump, une personnalité façonnée par son activité professionnelle de promoteur immobilier new-yorkais, de constructeur d’immeubles. Et le métier de promoteur immobilier ; surtout dans ce contexte ; a la réputation de gens qui « rayent le parquet » tellement ils ont les dents longues.
La stratégie « Trump » semble donc être de faire des déclarations grandiloquentes qui mettent une énorme pression sur des entités dont on se demande, dans ce contexte, si ce sont des partenaires ou des concurrents.
On peut citer la «proposition » d’inclusion du Canada dans les États-Unis, l’énorme pression diplomatique sur le Panama pour une gestion pro-USA du canal, la possibilité d’y avoir recours à la force militaire, la pression diplomatique sur le Mexique et la Colombie pour accepter les migrants illégaux, la proposition d’achat ou d’annexion du Groenland, l’achat ou la prise de contrôle de la bande de Gaza…
Donc, certaines déclarations sont visiblement une façon de mettre de la pression sur un partenaire avant une négociation éventuelle. De la même manière qu’un commercial qui proposerait un prix hallucinant pour un produit, pour ensuite le baisser fortement afin de faciliter l’accord, la vente ; l’acheteur ayant alors l’occasion de gagner quelque chose, de s’en être bien sorti.
Les positions concrètes de Trump sur le conflit ukrainien ne sont pas encore clairement lisibles. Il semble vouloir sortir de la mauvaise posture occidentale dans ce conflit qu’il n’a pas voulu, sans vouloir perdre la face, tout en monétisant au maximum chacune de ses décisions et en renvoyant les dettes et les frais sur les européens.
Tout d’abord, l’attitude et les commentaires de Trump vis à vis de ce conflit est une déploration forte : des centaines de milliers de morts, de blessés, des deux côtés, de la destruction, du chaos. Il a souvent commenté cela, comme étant une chose qui ne serait jamais arrivé s’il avait été président en 2022. Il a déploré tous ces jeunes morts sur le champs de bataille, une grande tristesse et que tout cela doit stopper. Sur ce point, je crois Trump sincère. Visiblement, on peut lui prêter ici un réel humanisme et une certaine aversion pour la guerre militaire et ses conséquences humaines dramatiques.
Il en est autrement pour la guerre économique. Car, sur ce sujet, Trump ne semble avoir aucunes limites, plus aucun ami, et une attitude provocatrice et agressive.
Donc, sur ce point, nous savons à qui nous avons affaire. Un « businessman » anglo-saxon qui, visiblement, n’aime pas la guerre militaire, probablement parce qu’il voit cela comme une perte d’argent et de « ressources ».
L’arme économique ultime de Trump, quelques chose qu’il répète souvent, ce sont les fameux droits de douane. Il s’appuie donc sur le poids économique fort, quoique déclinant, du marché américain pour en barrer l’accès à ceux qui n’acceptent pas ses volontés.
Un autre aspect de la politique de Trump concernant le conflit ukrainien est aussi lié aux personnalités et à l’entente des deux protagonistes importants dans ce conflit. Il suffit de voir les précédentes rencontres, comme à Helsinki en 2018 ; Trump et Poutine s’apprécient mutuellement, il y a du respect, probablement une certaine fascination réciproque, une réelle entente et probablement amitié entre les deux individus. En tout cas, le «courant passe », alors qu’il ne passe visiblement pas entre Trump et des gens comme Macron, Trudeau ou Zelensky. Là encore, le réel témoin d’entente est : patriotes contre mondialistes.
Il sera intéressant de voir si Trump aura la même approche de « grosse pression » avec les russes, car ce qui peut marcher pour le Canada ou le Panama ne marchera peut-être pas avec la Russie. Il est facile d’écraser un faible, mais quand le rapport de force n’est plus le même et si vous traitez avec des gens qui sont loin de cette culture de « joueurs de poker », les résultats peuvent être surprenants et contre-productifs.
Récemment, Trump a parlé d’éventuelles sanctions sur la Russie pour la forcer à un accord de fin de conflit, mais on se demande de quoi il parle car il y a déjà des milliers de sanctions occidentales avec la Russie et les relation économiques États-Unis/Russie sont aujourd’hui quasiment au point mort. Quel est alors son levier économique de négociation ?
Avec ce nouveau président américain, les cartes semblent être totalement redistribuées. Trump n’hésite pas à critiquer ouvertement et remettre en question les traditionnels alliés ou vassaux européens. Il remet en cause la participation financière américaine dans l’OTAN alors qu’ils en sont les chefs de file. Tout cela cause une certaine fuite en avant, une panique chez les leaders européens plus que jamais russophobes mais qui voient s’amoindrir le soutien américain, celui-ci ayant justement des contacts avec leur épouvantail.
D’un côté, nous avons vu Trump déclarer ouvertement faire un audit de 90 jours sur l’aide américaine à Kiev, et en même temps vouloir se rembourser des aides américaines avec des terres rares ukrainiennes.
Pour finir, l’ère Trump, qui se veut une « ère d’or », sera probablement, comme le disent certains analystes, un retour à une certaine rationalité, un renoncement à l’hégémonie mondiale des États-Unis et une consolidation de la puissance territoriale et régionale du pays, car Trump doit aussi lutter contre des forces internes, l’« état profond » américain.
Le leader de l’occident, comme civilisation malade, prend probablement une bonne décision pour se préserver car, quand on est malade, on n’est plus dans des phases « d’expansion ». Il faut d’abord le reconnaître, sortir du déni éventuel, rester chez soi et se soigner…en attendant que ça aille mieux.
Bruno Bardiès




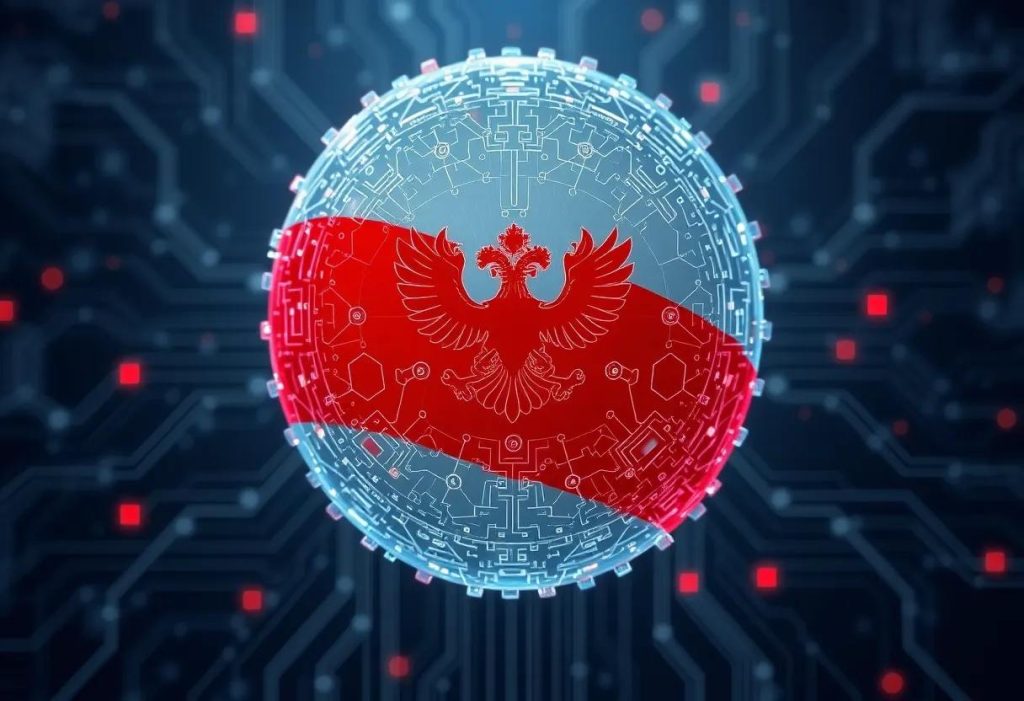



Autant Joe cherchait le pognon en multipliant les lignes de crédit, autant le Don il veut du cash tout de suite. Dans les deux cas ; pas vraiment de rationalité . Ça consiste juste à continuer à trouver les moyens de mener une politique impérialiste unipolaire… dans un monde qui n’y est plus adapté. Entre MAGA et Woke … ça vole pas haut dans les deux cas. Ils restent d’accord sur l’essentiel … inutile de leur demander leur avis sur la répartition de la valeur ajouté du travail.
En effet, je m’attends à voir du concret avant de bondir de joie. Les Américains font jamais rien par philanthropie.